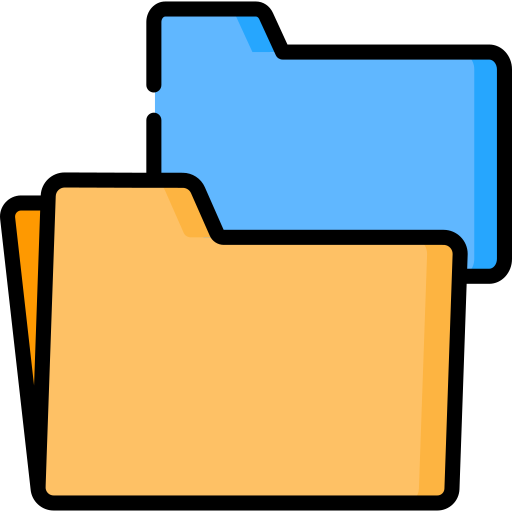Bonjour et bienvenue, je suis Juliette !
Et je suis Euna !


En ce mois des fiertés, L’amour est au menu (Tsukuritai onna to tabetai onna) commence sa publication française chez les éditions Akata, tandis que le one-shot Nos rendez-vous gourmands (Uo to mizu) a aussi droit à sa version papier !


Je crois voir un point commun…


Oui, aujourd’hui, on parle de cuisine et de la place qu’elle occupe dans la construction des identités et des solidarités japonaises aujourd’hui, à rebours de la culture gourmet et de la division traditionnelle du travail domestique !
Cet article fait partie d’une série sur la nourriture, la cuisine et la santé publique au Japon.
Parmi les nombreux ouvrages et colonnes de Eikan Kyū, les plus célèbres sont sans doute ses livres de cuisine, qui mélangent constamment recettes, conseils pratiques et méditations sur les relations humaines. Grande figure culinaire des premières décennies de l’après-guerre, Kyū est un Taïwanais ayant fait ses études d’économie à l’Université de Tokyo, avant de retourner à Taïwan. Après un exil à Hong Kong, il revient au Japon en 1954 et se consacre à l’écriture. En 1957, il publie Shoku wa Kōshū ni ari (C’est à Guangzhou qu’on cuisine) qui devient un manuel de référence pour une génération de Japonais encore minée par la guerre. L’approche de Kyū est singulière, puisqu’il se trouve à la croisée entre les mondes japonais, taïwanais et chinois, fait montre d’une solide érudition et incarne la figure du businessman proactif, mais bienveillant. Il n’oppose jamais frontalement la cuisine japonaise et cantonaise, mais souligne leur complémentarité et leurs racines communes avec la place fondamentale du riz1.
Il ne cherche jamais à froisser les mentalités japonaises en évoquant leur passé impérialiste et leur défaite militaire, allant plutôt chercher dans la mise en commun des savoirs et un syncrétisme culturel : il était ainsi connu pour accueillir à sa table de nombreuses personnalités de la vie artistique japonaise pendant trois décennies, sorte de salon culturel où la nourriture avait une place centrale. Dans Kyū hanten no Menu (Au menu de la cuisine de Kyū, 1983), il revient sur cette période, en offrant un panorama riche de la vie culturelle tokyoïte : des lauréats de prix littéraires côtoient des producteurs importants de la télévision autour de plats spécialement préparés en fonction des invités. Au chapitre 22, il explique que la cuisine de restaurant regroupe à la fois celle qui est préparée pour les clients, mais également celle pour le reste de l’équipe. Et que, forte de cette philosophie, une cuisine qui cherche à être délicieuse retourne toujours à des racines plus simples, « de même qu’un artiste habitué à peindre de sublimes miniatures décide de revenir à des lignes simples ou des techniques plus sommaires »2.

Une telle philosophie fait de la table de Kyū un espace accueillant et convivial, où l’amour de la nourriture l’emporte sur les faveurs interpersonnelles. Plus qu’un endroit où chacun vient pour performer une culture gourmet, il s’agit de la table où l’on mange le mieux – une curiosité exquise dans une société où il était plutôt coutumier d’inviter à dîner à l’extérieur, plutôt qu’au domicile de l’hôte.
Tu devrais cuisiner comme ça pour moi.


Eh, mais c’est déjà le cas, je te préviens !
Quelques aspects de la culture gourmet
Avant d’évoquer des situations plus modernes et d’analyser Tsukuritai onna to tabetai onna et Uo to mizu, quelques mots rapides méritent d’être glissés à propos de la culture gourmet qui a connu un essor remarquable à partir des années 1970. Si l’auteur Takeshi Kaikō est un avide pêcheur depuis ses années de journaliste et sa couverture de la guerre du Vietnam, il devient célèbre un gourmet reconnu à partir de la fin des années 1970, avec la publication de romans comme Romanée Conti 1935-nen (1980)3 ou d’essais comme Saigo no bansan (La Cène, 1975). Dans une prose parfois sinueuse, il y explore respectivement les souvenirs évoqués par le vin français et la cuisine chinoise, à rebours de la Révolution culturelle. Pour Kaikō, être un gourmet est un acte d’exploration, qui doit inviter à ouvrir des fenêtres sur d’autres cultures, afin de parfaire une grille esthétique personnelle. Tomoko Aoyama analyse cette démarche de gourmet comme différente de celle de Eikan Kyū, en cela qu’elle n’est pas uniquement motivée par un souci historique ou d’hospitalité, mais également par un accomplissement de soi, dirigé vers l’extérieur – une sorte de conquête du monde à travers la nourriture4 –, ce qui est particulièrement visible dans des titres comme Hōchōnin Ajihei (Jirō Gyū, Big Joe, 1973-1977). D’une certaine façon, cette démarche tend à créer une opposition entre la cuisine domestique et une véritable culture gourmet, qui vise la diversité.

En réalité, cette dichotomie existe déjà depuis plusieurs décennies et on en trouve une illustration dans le magazine culinaire Kuidōraku (L’Épicurien, 1905-1907), qui entérina la tension entre la cuisine économique à la maison et culture gourmet dans les grands restaurants du pays, à travers deux rubriques distinctes qui ciblaient différentes démographies5. Les années d’après-guerre voient la synthèse et la continuation de ces approches. Dans le monde du manga, Oishinbo (1983-2014) de Tetsu Kariya et Akira Hanasaki cherche à se détourner de la grande cuisine et des produits importés d’Occident. Le protagoniste Shirō Yamaoka officie comme journaliste gastronomique et doit établir, avec sa collègue Yūko Kurita, un menu d’exception pour le Tōzai Shinbun. Yamaoka conserve néanmoins l’approche extérieure de la quête culinaire, en voyageant régulièrement pour trouver des ingrédients, parfaire ses techniques et rassembler des connaissances. D’une certaine manière, Oishinbo est le représentant parfait d’un néo-traditionalisme, qui combine un farouche nationalisme culinaire et une vision très masculine du monde de la cuisine – toujours en opposition à la cuisine domestique laissée aux épouses.
Oishinbo avait ainsi été très critique des progrès technologiques, de la modernité urbaine et des influences occidentales, arguant que les traditions et la frugalité sont des aspects centraux de la cuisine japonaise. La sobriété gastronomique permet de tracer une opposition franche entre le travail de la terre et le labeur manuel d’un côté ; et le monde corporatiste et capitaliste de l’autre. Une telle philosophie continue à traverser la production culturelle actuelle, mais elle a été largement décriée par les critiques féministes et mise à mal par les crises économiques à partir de la fin des années 1980, qui obligent à se détourner des restaurants de luxe pour proposer une nouvelle vision de la culture gourmet.

Shin-Ei Animation, Oishinbo, épisode 3, 1988.
Si Shokugeki no Sōma (Food Wars!, 2012-2019) de Yūto Tsukuda et Shun Saeki poursuit toujours ce sillage de la cuisine comme dépassement de soi, de nombreuses exceptions existent dès la fin de l’ère Shōwa. En 1970, Aya Ichinoki et Moto Hagio publient Cake Cake Cake, un court manga mettant en scène l’amour d’une jeune fille pour les pâtisseries, qui l’emmène jusqu’à Paris pour découvrir l’arrière des fourneaux. De même, sorte de miroir à Oishinbo, Tochi Ueyama commence la publication – encore en cours – de Cooking Papa (1985), illustrant une cuisine domestique et hospitalière, destinée à la famille, aux collègues et aux amis. Ces deux œuvres défient l’image d’une masculinité virile en cuisine, en rappelant les enseignements de Eikan Kyū.
Mais ils restent quand même dans un cadre mental bien délimité !


Oui, aussi subversifs soient-ils à leur époque. Dans Cake Cake Cake, les sucreries sont des péchés mignons féminins, tandis que Cooking Papa conserve le cadre de la famille nucléaire hétérosexuelle. C’est la manière de faire de la cuisine qui brise les codes, mais pas nécessairement le projet social à l’échelle macro.
Recompositions sociales depuis les Décennies perdues
Dans le milieu des années 1980, le Japon entre dans une économie de bulle. Dans les décennies précédentes, le Japon avait solidifié sa position parmi les puissances économiques les plus importantes grâce à un ambitieux programme de modernisation et des exportations nombreuses dans le domaine de la technologie. Le niveau de vie moyen s’éleva rapidement et cimenta l’idéal de la classe moyenne urbaine, majoritairement composée de salariés travaillant pour de grands conglomérats (keiretsu), en même temps qu’une confiance démesurée pour la croissance s’installait dans les milieux financiers. Néanmoins, en 1990, le marché boursier s’effondre, suivi par le marché de l’immobilier en 1991, à cause de la fragilité de la gouvernance banquière et l’appréciation continue du yen, ouvrant ce que sont communément appelées les « Décennies perdues » (Ushinawareta ○-nen)6.
Dans les années 1990, le chômage augmente significativement, tandis que le mythe de la sécurité de l’emploi s’effondre. Pour un jeune homme, trouver un poste dans une moyenne ou grande entreprise était gage de stabilité et l’idéal était de rester dans cette même entreprise pendant l’entièreté de sa carrière. Après la bulle économique, la législation a été assouplie pour permettre l’essor du travail à temps partiel. En particulier, 54,5 % des femmes actives occupaient un emploi non-régulier en 2012, qu’elles privilégient pour conjuguer la recherche d’un appoint économique et les tâches domestiques leur étant traditionnellement dévolues, dont l’éducation des enfants7. Dans le même temps, le taux de divorce augmente significativement, blessant le mythe de la famille nucléaire hétérosexuelle8.
Cette reconfiguration socio-économique a mis en avant d’autres modèles d’existence dans les grandes villes. En particulier, le modèle de la résidence seule a gagné du terrain chez les femmes, en cela qu’elle permet d’affirmer une indépendance économique hors du foyer parental – évitant ainsi toute proximité avec la figure du hikikomori –, sans s’encombrer de la question de la division du travail domestique ou des enfants.
Sur les réseaux sociaux, plusieurs figures incarnent cet idéal, bien qu’elles restent certainement éloignées de la réalité de la vie urbaine japonaise. Namiのくらし représente l’idéal urbain chic et moderne d’une office lady célibataire, partagée entre sa passion pour la cuisine, ses vacances et sa vie domestique. Ses recettes se veulent résolument modernes, combinant constamment des inspirations japonaises et occidentales dans une cuisine équilibrée et trendy. Son appartement est à l’image de sa cuisine : extrêmement bien organisé, minimaliste et moderne, tout en étant chaleureux à sa manière. Sorte d’idéal-type de l’élégance moderne, elle a rencontré un succès auprès des spectateurs étrangers.

Un autre exemple est 1人前食堂. Si elle est tout aussi élégante, ses vidéos sont davantage destinées à un public domestique et ses recettes sont plus accessibles, avec un commentaire sur le déroulement de la recette. Les plans sont moins chirurgicaux, la colorimétrie plus chaude, tandis que l’espace de cuisine et de vie est plus aéré que l’appartement de Namiのくらし. Elle incarne un idéal plus familier, plus homely, troquant volontiers les longues jupes d’intérieur et blouses de Nami pour des hoodies. Dans les deux cas néanmoins, il ne s’agit pas d’une cuisine professionnelle ou particulièrement technique. Les deux femmes soulignent l’idée d’une cuisine apprise organiquement : elles tiennent souvent leur couteau d’une manière sous-optimale, montrent parfois des mouvements maladroits et cuisinent régulièrement à partir de recettes vues sur les réseaux sociaux.

Leur cuisine s’apparente ainsi à une cuisine du self-care, pour elles-mêmes. Leurs vidéos irradient d’harmonie et leurs appartements sont de véritables cocons, où il est agréable de faire la cuisine avant de manger devant la télévision ou son smartphone. Contrairement à la culture gourmet des années 1980, elles actent aussi l’importance des konbini, n’hésitant pas à choisir leurs ingrédients au gré des promotions, tout aussi importants que les cadeaux de nourriture que la famille envoie parfois.
Finalement, il y a une sorte de retour à la cuisine domestique.


Parce qu’elle regagne en valeur à la faveur de la dislocation de la famille traditionnelle. Comme on va le voir, partager des repas à la maison reste une activité privilégiée et participe à la solidification de nouvelles solidarités.
Pour moi, pour les autres… et pour nous
La cuisine reste ainsi un élément d’apaisement même hors de la famille nucléaire hétérosexuelle. Dans les années 2010, un nouveau mode de vie progresse dans les grandes villes japonaises, la cohabitation hors de relations romantiques (dōsei)9. Ces colocations contrastent avec l’idée d’une vie intime inaccessible, en acceptant ou en invitant d’autres personnes dans la sphère intime de la maison, brouillant la frontière entre public et privé. Dans son enquête sociologique menée en immersion entre 2016 et 2019, Helena Grinshpun souligne que la nourriture occupe une place de choix dans les relations entre colocataires, en cimentant l’idée d’une presque-famille ou, à défaut, d’un lieu d’appartenance fort (ibasho) :
« All my interviewees related to common meals as one of the most gratifying and unifying aspects of shared living. […] Yet the centrality of food is not limited to the pleasure of communal eating. At the large Tokyo share house, there was a separate refrigerator placed in the common area and used to store common food, such as edible presents and food leftovers from collective and individual meals. The idea of storing leftovers addressed the apparently sore issue of those working until late hours and coming home hungry; the food was made available to them without having to ask.
The notion of feeding others is closely related to the issue of nurture, creating an association with a family home, [like this] older female tenant sharing her breakfast with a younger housemate. Through such practices, food becomes an axis of a particular mode of intimacy, based on the recognition of each other’s needs and the will to address them, yet without biding the residents to fixed domestic roles. Tanaka conceptualizes this format of personal relations as ‘mutual independence‘, implying both interdependence and care, and individual autonomy that would be inaccessible within the more hierarchal family scheme. »10
Il me semble que c’est à l’aune de ce constat qu’il faut analyser la nouvelle place de la cuisine, mise en avant par la culture populaire. Si certaines enquêtes soulignent que l’acte d’inviter des amis à manger à la maison sert aux mères se mettre en avant et d’échanger autour d’un plat11, des études longitudinales manquent pour observer l’évolution de certains comportements, notamment auprès des jeunes générations.
Anecdotiquement, certaines habitudes prises par les membres de la branche japonaise de Hololive et les commentaires enthousiastes des spectateurs laissent entendre des changements de mentalité que la recherche pourrait explorer plus en profondeur. Kazama Iroha a ainsi rapidement gagné un statut d’épouse parfaite, par le soin qu’elle prodigue aux autres membres, notamment à travers sa cuisine : outre les cookies qu’elle avait apportés à Oozora Subaru12, Shirakami Fubuki en offre un aperçu avec l’anecdote de l’omurice et du gâteau au chocolat spécialement préparés pour les goûts de Laplus Darkness13. De la même manière, Anemachi – la sœur de Hoshimachi Suisei – a gagné la réputation d’être une cuisinière attentionnée et généreuse, très heureuse de cuisiner pour les autres membres, comme l’expliquent Houshou Marine14 et Sakura Miko15. Similairement, la mère de Suisei organise un repas de Noël chaque année où sont conviées les membres de Hololive, mais les anecdotes peuvent se multiplier à l’envi.

L’idée d’une communion collective chez un proche autour d’un repas met à mal la dichotomie trop souvent entretenue entre l’intérieur (uchi) et l’extérieur (soto) dans les grandes villes japonaises. Tsukuritai onna to tabetai onna (Sakaomi Yuzaki, 2021-présent) et Uo to mizu (Gengorō Tagame, 2022) s’inscrivent également dans cette démarche. Les deux actent les dissolutions des solidarités traditionnelles du Japon moderne. Dans Tsukuritai onna to tabetai onna, les deux femmes vivent loin de leur famille, tandis que Uo to mizu met en scène l’isolation provoquée par l’épidémie de COVID-19. Ce besoin de briser la solitude se lit même dans les juxtapositions de leur titre en japonais : le premier se traduit littéralement par La femme qui veut cuisiner, la femme qui veut manger, tandis que le second est une locution qui ressemble au « comme cul et chemise » français.
Bien que la nourriture reste centrale dans les deux récits, ils ne s’encombrent que peu d’explications culinaires ou de longues recettes, préférant surtout mettre en scène la cuisine comme une activité dont le résultat cherche à faire plaisir à autrui. Cuisiner devient presque un prétexte pour se voir davantage et subvertit la place de la cuisine dans la mythologie hétérosexuelle japonaise. Nomoto s’indigne de l’objectification qu’elle subit de la part de ses collègues masculins ou de l’insistance de sa mère pour trouver un mari. De la même manière, Akira se montre particulièrement atteint par le sexisme de Koizumi, qui joue sur l’idée misogyne du « Christmas cake » invendu (クリスマスケーキ), expression des années 1990 pour parler des femmes de plus de 25 ans qui ne sont pas mariées – et deviennent indésirables.


Pour Yuzaki et Tagame, ces normes sociales sont dépassées16 et la cuisine sert à instancier la nouvelle réalité des rapports sociaux. Comme dans les share houses étudiées par Helena Grinshpun, les protagonistes cuisinent pour rendre service à une personne qu’ils apprécient et qui a un statut qui dépasse la simple amitié. Le care est au centre de leur relation, ainsi Kasuga qui s’occupe de Nomoto pendant ses règles ; et inversement, Nomoto qui prépare des plats pour sa voisine qui rentre tard du travail. Dans Uo to mizu, Akira finit régulièrement chez Kōji, que ce soit pour apporter des légumes frais ou pour se réfugier de la pluie. D’une certaine manière, tous ces personnages vivent déjà une vie de couple – ou simplement une grande intimité relationnelle – avant même qu’une quelconque idée de romance soit officialisée. Ainsi, on retrouve Akira en train de plier le linge pendant que Kōji s’affaire en cuisine, des activités traditionnellement dévolues aux femmes, dans le cadre de la famille nucléaire : il s’agit ici de redéfinir la division du travail domestique dans un cadre homosexuel.

Après tout, il n’y a rien de plus agréable que de cuisiner le plat préféré de quelqu’un.
Et inversement, il n’y a rien de plus doux que d’avoir son plat préféré après une dure journée !

Cuisiner à l’ère Reiwa
Les menus, eux aussi, reflètent les évolutions des dernières décennies et la distance prise avec la culture gourmet des années 1980. Uo to mizu se caractérise par une cuisine d’une grande diversité, qui essaie de multiplier des plats différents autour d’un ingrédient central. La cuisine japonaise croise des plats venus d’ailleurs, avec un tropisme pour la cuisine méditerranéenne. Kōji fait montre d’un solide palais et d’une connaissance gastronomique transversale, sans pourtant être un expert. Dans Tsukuritai onna to tabetai onna, Nomoto rêve de grands plats et ses choix s’arrêtent plutôt sur des classiques de la cuisine domestique japonaise, s’approchant du comfort food associé à la cuisine parentale.

Une analyse détaillée des menus de la classe moyenne actuelle mériterait un article à part, mais quelques remarques peuvent être faites ici. Dans les deux mangas, le style de cuisine est opportuniste, fluctuant selon les envies, les saisons et le prix des ingrédients – offerts dans le cas de Uo to mizu, en réduction pour Tsukuritai onna to tabetai onna. D’autre part, si la cuisine d’Uo to mizu est internationale, elle refuse l’étiquette de gourmet des années 1980, en restant dans le domaine domestique. La cuisine de Nomoto est moins aventurière, mais repose sur les grands classiques du comfort food japonais, en privilégiant également des plats faciles à partager.
Dans les deux cas, le rapport à l’alcool est également intéressant. Tous les personnages acceptent de boire, mais ils n’en font jamais la finalité du repas. Kasuga explique justement qu’elle a eu une mauvaise première expérience avec les jiǎozi dans un izakaya, parce qu’un client avait critiqué son choix de les commander avec du riz plutôt qu’avec une bière. À un moindre degré, Akira refuse une bière pendant le repas, parce qu’il préfère se concentrer sur le plat, plutôt que sur l’alcool. Cette critique du régime de l’izayaka, où la nourriture sert à éponger l’alcool, se retrouve par ailleurs dans Kodoku no Gourmet (Le Gourmet solitaire, 1994-2015) de Masayuki Qusumi et Jirō Taniguchi. Le protagoniste n’y boit pas d’alcool et est souvent pris en défaut lorsqu’il se rend dans des izakaya.

D’autres normes gastronomiques y sont également critiquées, comme le stigmate autour des hommes qui consommeraient des sucreries – ce que Uo to mizu subvertit également avec les bouchées de chocolat. Tous ces mangas prennent acte des nouvelles modalités autour de la cuisine. Cuisiner gras est acceptable, tout comme faire attention à son budget, utiliser des nouilles instantanées, manger beaucoup et ainsi de suite. La cuisine de l’ère Reiwa n’est pas le pré carré d’experts gourmets – qu’ils soient des aventuriers internationaux ou des défenseurs d’une cuisine japonaise frugale –, mais bien une activité ouverte au plus grand nombre, qui permet de créer de nouvelles solidarités.
Cette observation est au cœur d’un nouveau mouvement au sein du manga de cuisine, avant tout préoccupé par des questions sociales. On pourrait citer en vrac Shin’ya shokudō (La Cantine de minuit, Yarō Abe, 2006-présent) et son idée d’un restaurant qui sert à capturer une tranche sociologique du Kabukichō d’aujourd’hui, mais l’idée de chercher du confort dans un café auprès d’un chef qui fait office de confident se retrouve également dans Shiosai no majo (La sorcière au bord de l’océan, Mogusu, 2019-2021). Bokura no shokutaku (Notre table à manger, Ori Mita, 2015-2017) met en scène la recomposition d’une famille nucléaire avec un couple homosexuel, tandis que dans Maiko-san chi no Makanai-san (La maison des maiko, Aiko Koyama, 2016-présent), Kiyo devient cuisinière dans une maison de maiko et participe ainsi à la vie de la communauté sans être sous les feux des projecteurs.

Si aujourd’hui les réseaux sociaux mettent souvent en avant des figures qui hurlent à l’authenticité culinaire à tout prix – il suffit de voir l’engouement provoqué par Uncle Roger –, il convient de ne pas oublier que celle-ci est une construction socio-culturelle et que des variantes régionales existent partout. Plus encore, la cuisine reste un moyen d’expression et un ciment pour des communautés aujourd’hui fragilisées. Dans les grandes villes, nous l’avons vu, il s’agit d’une manière de refonder des solidarités hors de la famille traditionnelle, à travers de puissantes formes d’amitié ou dans des couples homosexuels. Néanmoins, la cuisine sert aussi de marqueur d’identité fort, que ce soit pour les communautés indigènes comme les Ainu17, les habitants du Tōhoku après la triple catastrophe de 201118 ou certaines communautés rurales démantelées par certains grands travaux publics au Japon19. Mais cet article n’était qu’une introduction à ce qu’il est possible de voir dans les food studies et ce sont des thèmes pour une autre fois !
J’ai vraiment envie d’onigiri grillés maintenant. Avec du miso de Sendai !


Tu sais que c’est dur d’en trouver…
- Tomoko Aoyama analyse la figure de Eikan Kyū comme une combinaison habile de la connaissance (wen), aussi bien traditionnelle que moderne, et de la force masculine (wu) ici représentée par son passé de businessman. Son côté affable et conversationnel, ainsi que la manière dont il manie les références chinoises, japonaises et occidentales, font de lui l’idéal-type d’un érudit. C’est cette posture qui lui permet ainsi de populariser une vision pragmatique, mais érudite, de la cuisine domestique. Sur le sujet, voir Tomoko Aoyama, « The Cooking Man in Modern Japanese Literature », dans Kam Louie, Morris Low (dir.), Asian Masculinities: The meaning and practice of manhood in China and Japan, Routledge, Londres, 2003, pp. 155-176. ↩︎
- « ちょうど巧緻をきわめた細密画を描いていた人が、簡単な線か、省略した手法で絵をかくようになるのと似たような心境である » (Eikan Kyū, Kyū hanten no Menu, 1983). ↩︎
- Le monde du vin est un peu à part dans la culture gourmet, mais on peut citer Kami no shizuku (Les Gouttes de Dieu, 2004-2024) qui entame un profond travail de vulgarisation autour de l’œnologie. Le manga étant relativement récent, il a déjà subi les inflexions des Décennies perdues – évoquées plus loin dans cet article –, se focalisant autant sur la création du vin d’un point de vue matériel, l’exploration de nouveaux horizons gustatifs et esthétiques, mais aussi les modalités de consommation en fonction des classes sociales. ↩︎
- Tomoko Aoyama, op. cit. ↩︎
- En 1906, Kuidōraku crée le Shoku shikai qui rassemble des personnes qui doivent cuisiner et apporter leur propre nourriture sur le lieu de rendez-vous et échanger leurs plats, tandis que des mets plus exotiques sont également présentés par les organisateurs. Dans le même temps, le second groupe, le Kuidōrakukai est un rassemblement de gourmets avec de larges moyens financiers qui explorent la carte d’un restaurant huppé, avant d’en écrire la critique. Sur le sujet, voir Eric C. Rath, « For Gluttons, Not Housewives: Japan’s First Gourmet Magazine, Kuidōraku », dans Andreas Niehaus, Tine Walravens (dir.), Feeding Japan: The Cultural and Political Issues of Dependency and Risk, Palgrave Macmillan, Cham, pp. 100-108. ↩︎
- Les mécanismes macro et micro-économiques derrière l’effrondrement de la bulle sont complexes, tout comme les conséquences de cette rupture. En particulier, le maintien du yen à un haut niveau de compétitivité pendant les années 1990 reste une question non élucidée. Ainsi, l’historiographie continue à débattre de la qualification de Décennies perdues, qui pourraient englober seulement les années 1990 ou également les années 2000, sur la base de certains indices économiques. Certaines positions arguent que les années 2010 font aussi partie des Décennies perdues. La question dépasse le cadre de ce blog et le terme de « Décennies perdues » sera ici généralement employé pour englober la période qui s’étend grosso modo du début de l’ère Heisei (mort de l’empereur Hirohito, 1989) à la triple catastrophe du Tōhoku (2011), en mettant l’accent sur l’accroissement des inégalités sociales, la mise à mal du mythe du salaryman, la perte de confiance dans les grandes entreprises, la dislocation du système éducatif, l’affaissement des solidarités traditionnelles et de la famille nucléaire. Une telle approche suit globalement les mentalités des Japonais, qui, à la fin des années 2000, avaient tendance à voir ces deux décennies comme difficiles à vivre par rapport aux époques précédentes. Je fais le choix de repousser les années 2010 de cette catégorisation, en considérant que la triple catastrophe du Tōhoku et l’ère Shinzō Abe (2012-2020) représentent des défis particuliers. Pour une introduction générale sur le sujet, voir Andrew Gordon, « Making sense of the lost decades », dans Yoichi Funabashi, Barak Kushner (dir.), Examining Japan’s Lost Decades, Routledge, Londres, 2015, pp. 77-100. ↩︎
- Andrew Gordon, op. cit., pp. 89-90. ↩︎
- Parmi les facteurs centraux, il est possible que rester au foyer et être économiquement dépendante du salaire de son partenaire n’était plus considéré comme une stratégie sensée, dans une économie en contraction à partir des années 1990. D’autre part, les difficultés économiques ont pu pousser les femmes sur le marché du travail, ne leur laissant plus le temps d’envisager une vie matrimoniale traditionnelle. D’autre part, les évolutions démographiques, le plus haut niveau d’éducation et les changements de mentalités depuis la fin du XXe siècle participent à dévaluer partiellement la famille traditionnelle et un mariage précoce, proposant des explications pour les divorces plus fréquents et la proportion plus importantes de célibataires. Sur le sujet, voir Hiroshi Ono, « Divorce in Japan: Why it happens, why it doesn’t », dans Magnus Blomström, Sumner La Croix (dir.), Institutional Change in Japan, Routledge, Londres, 2006, pp. 221-236. D’autre part, le ralentissement des mariages s’explique aussi par des coûts moyens élevés (5,28 millions de yen sur l’année fiscale 2003-2004 ; voir Recruit, Sexy kekkon: Trend chōsa, 2004), qui restent extrêmement prohibitifs dans une économie en contraction. Sur l’évolution des mentalités autour du mariage, voir Ryūichi Kaneko & al., « Attitudes toward Marriage and the Family among Japanese Singles », dans The Japanese Journal of Population, vol. 6, n°1, 2008, pp. 51-75. ↩︎
- Cette pratique a connu une poussée pendant les années 1990, peut-être à la faveur des conditions économiques moins favorables, avant une légère décrue dans les années 2000. Sur le sujet, voir Ryūichi Kaneko & al., op. cit., p. 61. ↩︎
- Helena Grinshpun, « Crafting a new home: shared living and intimacy in contemporary Japan », dans Japan Forum, vol. 35, n°5, 2023, pp. 518-519. ↩︎
- En particulier, il semble que pour les familles avec enfants, les femmes restant au foyer apprécient d’inviter des amis chez elles pour manger, aussi bien pour mettre en avant leur individualité et leur technique culinaire. Au contraire, les femmes avec un emploi à l’extérieur ne privilégient pas cet aspect de présentation de soi, mais cherchent plus simplement à passer du temps avec leurs amis. Cette différence peut s’expliquer par le fait que la cuisine domestique est une charge devenue routinière pour les femmes restant au foyer et qu’inviter autrui oblige à changer son menu et à sortir d’une certaine zone de confort. La présence d’un enfant est également importante, dans la mesure où elle paraît inciter les mères à chercher des retours sur leur cuisine auprès d’amis. Sur le sujet, voir Etsuko Matsuhima, « 乳幼児を持つ専業主婦と有職主婦における友人との共食の機能~料理に対する他者の評価に着目して », dans 家族関係学, vol. 31, 2012, pp. 77-90. ↩︎
- Mog_neg, 【手描き】強風でもフッ軽いろはすてっぷなウーバーござる!【風真いろは/大空スバル/ホロライブ/切り抜き】【切り抜き漫画】, 1er avril 2023. ↩︎
- Moc_neg, 【手描き】いろは殿!ホロメン達の胃袋をガッチリ掴む!【白上フブキ/猫又おかゆ/ラプラス・ダークネス/風真いろは/holoX/ホロックス/ホロライブ/切り抜き】【切り抜き漫画】, 25 novembre 2022. ↩︎
- Marine Ch. 宝鐘マリン, 【雑談】おはなし!最近のいろいろ【ホロライブ/宝鐘マリン】, 9 septembre 2020. ↩︎
- Miko Ch. さくらみこ, 【 ポケモンSV 】7日目 今夜こそはくるでしょう!そうに違いない!!!にぇ~ ホゲータ色違いが欲しい旅 ~【ホロライブ/さくらみこ】, 3 décembre 2022. ↩︎
- L’expression « クリスマスケーキ » est ainsi tombée en désuétude face à la hausse de l’âge moyen du mariage, bien que le stigmate reste encore réel. ↩︎
- Eiko Soga, Felt Knowledge: Ecologising Art and Samani Ainu Cooking, thèse de doctorat, University of Oxford, 2023. ↩︎
- Julia Gerster, « More than Mushrooms: Local Food Culture and Place-making after ‘Fukushima’ », dans Shu-Mei Huang, Elizabeth Maly (dir.), Community Responses to Disasters in the Pacific Rim, Routledge, Londres, 2023, pp. 77-94. ↩︎
- Ce sujet sera exploré plus en profondeur dans la troisième partie de mon documentaire sur le fleuve Sumida et les cours d’eau urbains. ↩︎