
Bonjour et bienvenue, je suis Juliette !
Et je suis Euna !


Dis, tu as peut-être vu passer le remake du premier Wizardry, qui a suscité quelques interrogations sur sa cible éditoriale. Je ne veux pas lancer le débat ici, mais je me demande comment on peut rendre la cartographie à la main plaisante sans complètement aliéner le public par la lenteur de l’exploration.

Tu sais, quand j’explore des cryptes avec mes compagnons, il n’y a pas le choix ! Si tu ne dessines pas ta carte, tu resteras perdue pour toujours !


Alors oui, mais contrairement à ton monde, on peut aller sur Internet et aller chercher une carte gentiment postée par quelqu’un d’autre…
Mais tu ne connais plus le plaisir d’être la première à cartographier l’inconnu !


Peut-être que ça n’est plus ce que les gens cherchent ! Mais c’est parfait, parce qu’on peut essayer de répondre à cette question en parlant un peu de Super Black Onyx, de la manière dont il diffère de la version d’origine, de son imaginaire esthétique et comment il a été bousculé par les titres du milieu des années 1980 !
En faisant une petite histoire du JRPG, il est coutumier de retenir quelques dates et moments marquants dans le milieu des années 1980. Dragon Quest (Enix, 1986) est peut-être le pilier le plus connu du grand public, mais petit à petit, des titres comme Druaga no tō (Namco, 1984), Hydlide (T&E Soft, 1984) et le grand corpus de Falcom – de Dragon Slayer (1984) à Ys (1987) – ont commencé à attirer l’attention du public, tous cités comme des premières explorations importantes. Malgré tout, il demeure l’idée d’une évolution presque linéaire du genre dans ses premières années. L’import occidental de Wizardry (Sir-Tech, 1981) donnerait naissance à Panorama-tō (Falcom, 1983)1 et Druaga no tō, tous deux des sources d’inspiration pour Dragon Slayer et The Black Onyx (BPS, 1984). Ils deviennent à leur tour cruciaux pour Hydlide, puis Dragon Quest, The Legend of Zelda (Nintendo, 1986), Ys, Final Fantasy (Square, 1987) et ainsi de suite.
On pourrait s’amuser à compléter cette petite liste à l’envi, en cherchant les influences successives, mais l’exercice est un peu puéril, si le but est de simplement tracer une généalogie idéalisée de jeux. Certains se sont livrés à l’exercice avec des aspirations plus humbles et A Guide to Japanese Role-Playing Games (bitmap, 2021) est une belle réussite, en cela qu’il sort des sentiers battus, tout en assumant que l’exhaustivité parfaite n’existe pas. Mais ça n’est pas le sujet de ce billet ! Aujourd’hui, je voudrais surtout évoquer Super Black Onyx (BPS, 1988), le remake de The Black Onyx, lequel est aujourd’hui crédité pour avoir popularisé le RPG au Japon, grâce à ses ventes convaincantes, à une époque où jouer à Wizardry demandait d’importer un ordinateur des États-Unis.
Les faussaires de l’histoire
L’année dernière, Felipe Pepe s’était à raison fendu d’un tweet en réaction à un article de Time Extension à propos de la genèse de The Black Onyx, sorte d’histoire incroyable où Henk Rogers, selon sa propre interview, aurait gagné un pari fou en apportant au Japon le jeu de rôle et la high fantasy.

L’article est troué de signes préoccupants comme les assertions jamais vérifiées de Henk Rogers, sa quasi-déification, l’invisibilisation presque complète de sa femme, Akemi Rogers, pourtant cruciale à la traduction et des sorties aux relents racistes qui bordent sur le narcissisme : difficile de prendre Rogers au sérieux quand il annonce que personne au Japon ne comprenait ce que pouvait être une illustration « d’un héros se tenant sur un tas de monstres, son épée à la main », comme si Momotarō n’existait pas. Si Dungeons & Dragons a été une influence décisive sur la high fantasy japonaise avec des succès exceptionnels comme Lodoss-tō senki (Ryō Mizuno, 1986), la littérature de l’imaginaire était déjà très dynamique, forte d’une grande variété de courants grâce aux différents prix et magazines littéraires, et souvent emmenée par des autrices devenues iconiques2. Pour ne prendre qu’un exemple parmi d’autres, Guin Saga (1979) de Kaoru Kurimoto, qui totalise 147 volumes, montre que l’heroic fantasy n’était pas inconnue au Japon.

La comparaison avec Billy Mitchell par Felipe Pepe n’est pas anodine : on retrouve les mêmes mécanismes d’obsfucation de l’histoire à des fins promotionnelles et de la mise en spectacle du soi, avec la certitude que les sources sont inexistantes ou trop faibles pour essayer de déceler ce qui s’est vraiment passé. Le milieu journalistique du jeu vidéo se contente souvent de ces success stories, parce qu’elles vendent bien et flattent l’égo de cette première génération de développeurs, à l’heure où leur réputation décline face aux personnalités japonaises.
Malgré ces remarques acides, il ne s’agit pas de représenter Rogers comme un monstre et de mettre sur un piédestal les développeurs japonais, puisque chacun accuse de leurs tares personnelles. Il s’agit seulement d’excentrer l’histoire du jeu vidéo, en ne se focalisant pas sur les titres les plus connus ou les personnalités perpétuellement mises sous le feu des projecteurs. Une histoire moderne doit examiner des supports moins connus, des démographies plus silencieuses et des espaces géographiques peu privilégiés par les grands sites de presse. C’est aussi tracer des ponts au-delà du jeu vidéo et observer des réseaux d’influences parfois inconscients.
Rien que ça !


Oui, c’est un gros projet, mais qui se fait avec des petits pas. Et je suis sûre que tu seras là pour m’accompagner tout au long de cette aventure !
The Black Onyx et l’esprit de simplification
Quelques mots sur The Black Onyx, pour essayer de situer son approche de design. Le titre sort au début de l’année 1984 et se veut une simplification de la formule du dungeon crawler qu’avait développée Sir-Tech avec la première trilogie de Wizardry. Ici, nulle classe, race, sort, altération d’état ou liste d’inventaire ; les statistiques complexes sont remplacées par trois attributs : LIFE pour les points de vie, STR modifie les dégâts effectués et DEX la fréquence d’attaque. Le but est de créer une expérience digeste, facilement accessible et avec le moins d’éléments numériques visibles à l’écran. À certains égards, cet objectif est rempli, bien que le jeu doive faire des concessions sur certains aspects pour privilégier son approche visuelle. Il est possible de créer son propre personnage et de le voir évoluer à l’écran au fur et à mesure qu’il gagne de nouvelles pièces d’équipement.

Le titre ne prend guère de temps à évoquer son histoire, mais cela n’est pas un problème. L’écran titre est très suggestif avec la haute tour noire qui perce le ciel et les couleurs dansantes du Black Onyx. Le manuel fournit quelques bribes d’informations supplémentaires : le Black Onyx, cachée près du village isolé d’Utsuro, accorderait la jeunesse éternelle et la fortune à qui le trouvera. Après des années d’aventure, le joueur arrive dans la bourgade pour tenter de trouver la fameuse pierre précieuse. La simplicité marche dans le sens du jeu, avec l’ambiance pesante d’Utsuro, qui prend les aspects d’un village hanté. Pourquoi des gens vivent-ils à côté d’une tour aussi malfaisante ? Pourquoi avoir construit le village au-dessus de catacombes infestées de monstres ? Pourquoi y a-t-il une si grande prison ? Ce sont autant de questions qui ne trouvent pas de réponses, mais qui stimulent efficacement l’imagination du joueur.
Similairement à Wizardry, le joueur doit explorer les six étages du sous-sol pour s’équiper avant d’affronter les ultimes puzzles. L’aventure, si elle se montre parfois brutale, est relativement linéaire et le jeu est surtout connu pour la nature cryptique du labyrinthe de couleurs, au sixième sous-sol3, et les murs transparents lors de l’ascension la tour noire. Ces quelques gimmicks peuvent paraître cruels, mais l’ensemble reste facilement compréhensible et il n’est pas difficile de voir pourquoi le titre a plu à de nombreux jeunes joueurs, par son caractère expansif et sa relative facilité – comparé à Panorama-tō, par exemple.
Plus encore, le caractère épisodique laissait entendre qu’il serait possible de continuer l’exploration d’Utsuro et de ses environs dans les jeux suivants. C’est le cas avec The Fire Crystal (BPS, 1986), mais le studio ne développa jamais les deux autres volets, The Moonstone et Arena, ni d’ailleurs le revival que devait être The Secret of the Black Onyx.
Pourquoi n’y a-t-il jamais eu de suites ?


Dans son interview pour Time Extension, Rogers explique qu’il a été dépassé par le succès et « l’univers esthétique » de Dragon Quest, Final Fantasy et autres. Je trouve la remarque amusante étant donné que la différence visuelle n’est pas si grande et que la perspective aérienne avait déjà été bien explorée par la filiation d’Ultima en Occident et ailleurs…
Peut-être qu’il a considéré que ça ne rapportait pas assez d’argent de continuer sur cette voie, avec toute la concurrence ? Il a l’air d’aimer être le premier.


Difficile à juger… Mais parlons d’abord de Super Black Onyx.
Les faux dilemmes du menuing
Parmi les différents portages des années 1980, BPS s’est occupé de cinq d’entre eux, laissant à ascii le soin de la version MSX et à Sega celle pour SG-1000. Super Black Onyx est la version Famicom et prend de considérables distances avec le titre d’origine, en ignorant toute l’histoire et le design du donjon. Le Black Onyx devient ici une pierre précieuse qui aurait été créée par les dieux pour emprisonner l’énergie chaotique du Ragnarok. Le prêtre Moondog avait prédit que les humains tenteraient de voler l’Onyx et demande ainsi au joueur de le récupérer pour le sceller à tout jamais, dans les plus lointains recoins de l’univers. Les proportions démesurées de la quête vont de pair avec l’extension de l’aire de jeu, puisque Super Black Onyx propose d’explorer soixante étages pour parvenir au fameux Black Onyx. Le village d’Utsuro n’existe d’ailleurs plus, remplacé par un hub d’échoppes quelconques.


En vérité, les similitudes avec le jeu d’origine se résument à quelques éléments empruntés et aux vagues ruines de l’esprit de simplification. Il est probable que BPS ait été effectivement chamboulé par l’arrivée de nouveaux compétiteurs, qui sont parvenus à simplifier encore plus élégamment la formule RPG en rejetant partiellement l’héritage dungeon crawler pour le bump combat et des aventures moins claustrophobes. La simplicité tactique d’un Dragon Quest rend aussi obsolète les menus encore lourds de The Black Onyx et BPS aurait peut-être voulu répondre en rendant renforçant l’aspect visuel de son système de combat.
Le résultat est un peu déroutant. Plutôt qu’un menu d’actions, le groupe du joueur fait face aux monstres et les personnages jettent automatiquement leur arme sur eux. Pendant ce laps de temps, le joueur peut modifier la trajectoire, avant de valider – ou non – une attaque avec le bouton A. La danse continue jusqu’à ce qu’un groupe soit annihilé ou que les ennemis fuient. Au lieu d’avoir une expérience traditionnelle au tour par tour, Super Black Onyx se pare d’une couche d’interactivité supplémentaire, qui oblige le joueur à être présent mentalement pour sélectionner les ennemis qu’il souhaite attaquer.


Si l’on s’accommode rapidement de cette fantaisie de gameplay, Super Black Onyx fait le choix de multiplier les complications et les nuances. Là où The Black Onyx n’avait qu’une classe de guerrier, le joueur peut ici choisir entre Heroes, Monks et Mages, chacun ayant leur type d’armes. Les deux derniers alternent ainsi entre sorts offensifs, défensifs et utilitaires – pendant et en dehors des combats. Il faudra ainsi acheter les bonnes armes pour équiper les casters, aussi bien pour augmenter leurs dégâts que la survivabilité du groupe. Pour les guerriers, le choix n’est plus entre les armes à une main ou à deux comme dans The Black Onyx4, mais le choix entre une arme rapide ou lente en fonction du niveau du personnage, puisque manier une arme à un niveau trop bas empêche les attaques successives comme sur l’illustration ci-dessus.
C’est d’ailleurs ce point-là qui fait la différence principale dans la manière dont il faut aborder la progression dans Super Black Onyx. En plus de la barre de vie, il faut protéger les barres de STR et DEX, qui diminuent à chaque attaque. Le jeu devient ainsi un marathon, où la préservation des ressources est essentielle. Pour donner corps à cette philosophie, Super Black Onyx propose ainsi le nombre faramineux de soixante étages, ponctués par des murs noirs et des fontaines.
Sur la carte, il y a une sorte de conduit avec des murs noirs. C’est la fameuse tour de The Black Onyx ?


C’est une bonne intuition, Euna… mais elle est fausse. On ne retrouve pas la Black Tower, ici. Elle a été mélangée avec d’autres éléments du jeu d’origine, tu vas voir.
Aventures sous soixante cieux
À l’image de Final Fantasy qui fait un pied de nez à Dragon Quest en sauvant la princesse Sara de Garland dans son prologue, Super Black Onyx condense l’aventure de The Black Onyx dans son segment d’ouverture. Les aventuriers peuvent descendre et explorer les six étages du sous-sol sans véritable opposition, avant d’arriver vers ce qui semble être un cul-de-sac avec la vue sur les profondeurs d’un océan. À partir de là, nul autre choix que de remonter en ville pour commencer à explorer les étages supérieurs, la grande nouveauté du titre.

Le labyrinthe de couleurs laisse place à une succession d’environnements différents, déployés sur six à huit étages environ. Cette diversité cherche à mettre en avant les capacités graphiques de la Famicom et la richesse de l’univers, mais le résultat est certainement à l’opposé des attentes. Les sections interminables qui se doublent de cul-de-sac inutiles rendent la cartographie frustrante et la monotonie visuelle s’installe bien rapidement5. Quelques panoramas ponctuent bien l’exploration, mais ils n’arrivent jamais à la hauteur du premier écran et de la vue sur un lac étrange, sur lequel veillent des arbres aux allures fongiques.
Roger Dean avait été engagé pour la jaquette du jeu et il avait livré une vue saisissante, dans la lignée de ses productions précédentes. Souvent sinueuses, ses peintures exhibent des paysages impossibles, des arbres qui se tordent en spirales et des montagnes qui semblent avoir fusionné avec des constructions humaines ou d’autres éléments naturels. Pour autant, ses univers restent au précipice du réalisme, rappelant les paysages anglais et écossais qui sont aux sources de ses inspirations. Super Black Onyx aurait pu chercher à développer cet imaginaire, en gravissant une tour ésotérique et creusée par des influences diverses.


Après tout, l’idée n’est pas si incongrue. Zak Sabbath et Patrick Stuart l’ont ainsi explorée dans Maze of the Blue Medusa (2016), un immense donjon de 304 salles pour OSR. Inspiré par des peintures fantasques et décadentes, le module superpose des univers visuels et des inspirations esthétiques pour créer un labyrinthe intemporel, où plusieurs sociétés ont évolué avant de s’éteindre, sous l’aura passive de la Méduse et de sa fièvre artistique. Rien de tout cela dans Super Black Onyx, qui s’éteint rapidement dans le convenu. L’ascension passe sans se faire remarquer et il est difficile de ressentir un émerveillement particulier pour la Golden City, la vue des tours ou des nuages dans la dernière ligne droite avant le Black Onyx, tant ces environnements sont désincarnés, simplistes et détachés de la progression du joueur.


Il ne reste que de longs allers-retours et des reliquats des catacombes d’Utsuro. La tour noire est reprise visuellement avec les murs d’onyx qui servent de téléporteurs et de checkpoints dans l’exploration. L’idée du conduit de 2×2 a été conservée en l’associant au puits de The Black Onyx. Dans la version d’origine, il est possible de descendre dans les souterrains via un puits, avant d’être surpris par un Kraken. Celui-ci est un ennemi très marquant et sert effectivement à tester la puissance du groupe. Si celui-ci triomphe, il débloque un raccourci gratifiant vers les profondeurs. En même temps, une rencontre trop prématurée a le mérite d’être un moment mémorable et de renforcer l’étrangeté du village. Rien de tout ça dans Super Black Onyx : le conduit est accessible vers la fin du jeu, quand le joueur explore le dernier environnement et sert de point de téléportation entre les différents environnements, mais est essentiellement inutile à ce stade6.
Après tout, multiplier par dix le nombre d’étages dilue forcément les idées et surprises qui peuvent marquer le joueur.


Oui, c’est bien le problème du jeu. Il manque trop de substance pour être autre chose qu’une épreuve de cartographie sans fin. D’une certaine manière, ça me rappelle la philosophie très agressive et frustrante du premier Wizardry dans sa seconde moitié.
Ah oui, avec les étages 5 à 8 qui sont complètement optionnels, sans objets clefs et avec trop de pièges pour être agréables.


C’est un peu pareil ici, sans les pièges, mais avec les mêmes couloirs qui partent dans tous les sens, alors qu’il n’y a absolument rien à trouver. Parce que Super Black Onyx ne donne aucun indice, trouver les objets importants, même s’ils ne sont pas obligatoires, revient à chercher une aiguille dans une botte de foin…
Le secret de l’onyx noir
Personne ne semble trop vouloir parler de Super Black Onyx, y compris Henk Rogers. Comment pourrait-il en être autrement ? Le projet parait avoir été porté par l’appât du gain, à l’heure où la Famicom devenait une plateforme privilégiée. Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord avait eu son portage sur la console quelques mois auparavant et BPS avait peut-être voulu profiter de cette vague, voire damer le pion avec une version mise à jour de The Black Onyx en arguant de capacités techniques supérieures. La réalité est que Super Black Onyx a été piégé entre la grammaire traditionnelle du dungeon crawler occidental, qui possède son propre charme et sait être très efficace, notamment dans les quatre premiers étages de Wizardry, et une formule plus digeste inspirée d’Ultima, Hydlide, Ys, Dragon Quest, Final Fantasy et ainsi de suite. Lorsque Rogers explique qu’il ne comprend pas l’esthétisme japonais, il faut surtout lire, entre les lignes de cette remarque qui dénote une méconnaissance de la production domestique, qu’il a été réduit à l’obsolescence sur sa droite et sa gauche.
Faut-il ainsi s’étonner que Rogers quitte ainsi la création à proprement parler pour aller s’engouffrer dans la grande épopée qu’est Tetris, peut-être son plus grand succès et la raison de sa célébrité aujourd’hui ? S’ils sont véridiques, les mails qu’il aurait échangés avec un développeur dans la fin des années 1990, après que The Tetris Company avait menacé d’intenter des actions en justice pour violation du droit d’auteur, révèlent certaines priorités :

Le choix de se présenter comme un businessman avant tout porte à réflexion et renseigne sur d’autres décisions. En 1997, Henk Rogers dévoile à travers BPS – alors renommé Blue Planet Software – The Secret of the Black Onyx, un card-based RPG avec Moondog, le prêtre de Super Black Onyx, comme protagoniste. Le développement devait rassembler des talents (Roger Dean, Alex Pajitnov, Michael Kaluta, etc.) pour produire une aventure en 3D avec motion capture et chorégraphies professionnelles7. Le projet ne vit jamais le jour et il est tentant d’analyser cela comme la création artificielle d’un engouement pour un projet qui serait évidemment annulé, rappelant les habitudes de Peter Molyneux.


Le design paresseux de Super Black Onyx, à mille lieux des petites idées qui faisaient la magie du titre d’origine, pourrait ainsi se lire comme un opportunisme financier. À défaut d’être un mauvais jeu, ce qu’il n’est définitivement pas en proposant une expérience massive dont l’emphase est la cartographie, Super Black Onyx révèle peut-être la nécessité de ne pas succomber à la mise en scène de certains développeurs. Henk Rogers, bien que The Black Onyx mérite son succès et qu’il ait été une figure importante pour la démocratisation de Tetris, n’est pas le génie insoupçonné du jeu vidéo. Son image de marque actuelle est finement construite, à travers ses projets actuels dans le stockage d’énergie ou le biopic Tetris (2023) par Jon S. Baird. Les nombreuses omissions dans ses interviews à propos des personnes qui l’ont aidé – son épouse Akemi en premier lieu – et ses formules sentencieuses sur l’état de la production culturelle japonaise ne sont pas des erreurs isolées.
Il faut ainsi de décentrer l’histoire du jeu vidéo des généalogies de titres à succès et du storytelling autour des designers de génie. Certes, les studios japonais laissent parfois plus de place au producteur, qui récupère des fonctions habituellement réservées au réalisateur, coiffant ainsi le projet d’un producteur exécutif. Mais une focale trop insistante sur ces figures voile le reste de l’équipe et participe à la confusion savamment entretenue autour du terme d’indies, qui englobe aujourd’hui bien plus que des projets en solitaire, mélangeant allègrement « jeux d’auteurs », titres non-AAA et de simples esthétismes.
Je pensais qu’on allait juste parler de cartographier des donjons.


Tout est un prétexte pour parler de société. C’est un peu la shakai-ha, ici.
- Les connaisseurs de Rampo Edogawa auront immédiatement noté la référence, puisque le jeu paraît assez largement inspiré de Panorama-tō kitan (1926). Le récit policier est ici troqué contre une descente dans l’absurdité de l’île, où le joueur peut rencontrer différents habitants plus étranges les uns que les autres. Chez Rampo Edogawa, le récit met en scène l’île comme une échappatoire à la modernité occidentalisée de Tokyo. Pour le personnage principal, Kōsuke Hitomi, construire et s’abandonner dans l’utopie de son île lui permet de dissoudre sa propre identité en empruntant celle de Genzaburō Komoda et en s’éloignant de la capitale japonaise. Panorama-tō kitan se finit mal pour lui, puisqu’il est constamment rattrapé par le regard des autres, qui l’oblige à confronter sa propre existence, jusqu’au moment où il décide de se suicider en se plaçant dans des feux d’artifices. Le Panorama-tō de Falcom ne dit pas fondamentalement autre chose : « l’île de Panorama est juste une œuvre de fiction, c’est ce que vous pensez, n’est-ce pas ? Mais quelle est la différence entre la réalité et l’imagination ? […] Car l’île de Panorama existe dans les cœurs de chacun d’entre nous » explique ainsi le manuel. Il me paraît important de noter ces inspirations disparates en essayant de tracer une histoire culturelle complexe, plutôt que de se focaliser sur des généalogies linéaires et sujettes à des biais de confirmation. ↩︎
- Après une génération d’auteurs inspirés par l’esthétisme anglo-saxon, les années 1970 voient une diversification de l’offre culturelle et l’apparition d’autrices majeures qui se servent de la science-fiction comme lieu d’exploration de la corporalité. On retrouve ainsi Izumi Suzuki, Kaoru Kurimoto, Moto Hagio, Motoko Arai, Mariko Ōhara, Reiko Hikawa, Yūko Yamao, etc. Sur les autrices de science-fiction dans les premières générations, voir Kotani Mari, « Space, Body, and Aliens in Japanese Women’s Science Fiction », dans Science Fiction Studies, vol. 29, n°3, 2002. ↩︎
- Dans le village d’Usturo, on peut lire le célèbre「イロイッカイズツ 」(iro ikkai zutsu, « une couleur à la fois »), qui est censé guider l’exploration du dernier sous-sol. Néanmoins, l’ordre exact des couleurs n’est jamais indiqué et diffère selon les versions. La phrase est devenue connue auprès des amateurs japonais de dungeon crawlers, symbole du caractère impénétrable du puzzle. ↩︎
- C’est fondamentalement un faux dilemme. Il sera toujours préférable d’augmenter les dégâts et de compenser la perte du bouclier par la cape d’invisibilité. The Black Onyx est moins un jeu d’attrition qu’un sprint dans sa dernière séquence. ↩︎
- Une cartographie complète est disponible ici et présente bien les soixante étages. En réalité, le jeu les condense sur huit cartes de 32×32, comme l’illustrent bien ces cartes-ci. ↩︎
- Le conduit emprunte en fait l’idée de la Black Tower de The Black Onyx, en cela que le seul point d’entrée se trouve à l’étage 38 et que les murs sont à sens unique. S’il est possible d’emprunter cet escalier central pour se rendre dans les différents biomes, il n’est pas possible de l’emprunter pour passer de la ville de départ aux étages finaux, par exemple. À ce stade, le joueur ne devrait pas avoir à l’utiliser, puisqu’il se trouve dans la dernière ligne droite de l’exploration. Il est ainsi préférable de placer le point de retour dans la Golden City et d’utiliser TOPAZ pour se téléporter et recommencer l’exploration depuis l’étage 37. À la limite, l’ascenseur peut permettre d’accéder aux profondeurs aquatiques ou au temple pour obtenir quelques points d’expérience, mais fuir avec RUBY entre les étages 38 et 44 paraît encore plus sage. ↩︎
- Markus Krichel, « The Secret of the Black Onyx: Onyx – The Gathering », dans PC Games, n°61, 1997, p. 84. ↩︎



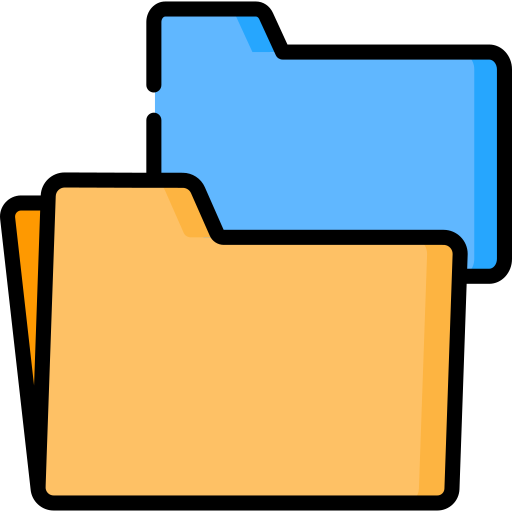





2 réponses à “Super Black Onyx : Les mirages des profondeurs”
Toujours un superbe travail de recherche ; très clair et en dehors des sentiers battus. Merci beaucoup !!
Merci beaucoup ! Heureuse que ça ait été agréable à lire !